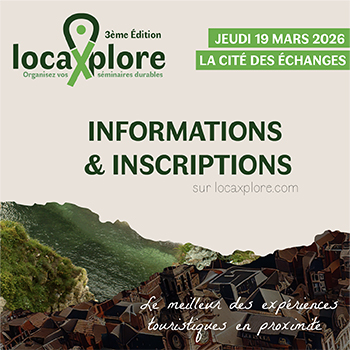Intégrer le transport à l’offre d’un site, c’est améliorer l’accueil, maîtriser ses impacts et sécuriser l’exploitation.
Pour un participant, le premier et le dernier contact avec l’événement, c’est le trajet. Retards, files de cars mal positionnées, véhicules qui tournent faute d’informations… sont autant de points de friction qui altèrent la perception du lieu. À l’inverse, un plan de mobilité visible sur son site web, des points de dépose-reprise signalés et des créneaux cadencés transforment ce « temps contraint » en partie intégrante de l’expérience et de la promesse de service du site. Dans les faits, de nombreux lieux constatent que la coordination en amont (repérages, scénarios de transport, brief chauffeurs…) fluidifie tout le reste de l’exploitation le jour J.
Un levier décisif de RSE
Dans l’événementiel, les transports et transferts concentrent 70 à 80 % de l’empreinte carbone. Faire « comme d’habitude » n’est plus tenable : mesurer, éviter et réduire s’imposent. Les lieux peuvent agir : favoriser des motorisations moins carbonées (électrique, GNV, biocarburants), encourager les transports collectifs pour regrouper les trajets (cars, minibus, vans…), et promouvoir l’éco-conduite. Formaliser ces choix dans une politique de mobilité responsable crédibilise la démarche RSE du site et répond aux critères croissants des donneurs d’ordres.
En ville, gérer les flux est devenu stratégique
Les centres urbains évoluent vite : généralisation des ZFE, restrictions de circulation et raréfaction du stationnement (à Paris, 70 000 places en moins entre 2021 et 2026). Les lieux doivent donc anticiper : définir des zones de dépose-reprise, limiter les kilomètres à vide via des partenaires locaux, organiser des navettes depuis des hubs (gares, parkings relais) et penser le « dernier kilomètre » (minibus, véhicules légers, cheminements piétons). Cette approche réduit la congestion aux abords, améliore la relation de voisinage et sécurise l’accessibilité PMR.
Ce que peut (et doit) proposer un lieu aujourd’hui
- Un « kit mobilité » standardisé à fournir aux organisateurs : plan des accès, créneaux de livraison/embarquement, points de rassemblement, chartes conducteurs…
- Des scénarios prêts à l’emploi selon la jauge : prévisions des rotations, cordon de cars mutualisé, « plan B » en cas de grève ou de mauvaise météo…
- Des partenariats avec des prestataires capables de déployer des transports localement, pour limiter les trajets à vide et renforcer l’ancrage territorial,
- Des choix de motorisations adaptés au contexte : électrique en rotation courte, biocarburants/HVO sur des liaisons plus longues, en gardant à l’esprit les contraintes d’autonomie et d’infrastructures,
- Une signalétique et une coordination de terrain (briefs, groupes d’échange en temps réel…) pour garder la main pendant l’exploitation.
Mesurer pour progresser
Le lieu événementiel doit exiger de son opérateur transport un bilan d’impact de la mobilité en trois temps : estimation amont, optimisation (regroupement, choix des véhicules, plan de rotation…) puis consolidation post-événement. Il doit intégrer ces données transport dans son propre bilan carbone. Ces données permettent de relier les arbitrages de mobilité aux autres postes d’impact (horaires, plan d’accès, choix des fournisseurs, mix énergétique). Ce chaînage rend visibles les effets rebond (par exemple, les horaires étalés provoquent moins de pics de navettes, d’attente et de moteurs tournant au ralenti) et facilite la priorisation des actions. Ensuite, partager ces résultats avec l’organisateur alimente ses reportings RSE, crédibilise la démarche et nourrit une amélioration continue côté lieu comme côté client.

Pour un lieu événementiel, reprendre la main sur le transport, ce n’est pas « faire du transport » : c’est orchestrer un maillon critique de l’expérience, sécuriser l’exploitation et démontrer une RSE tangible. Les lieux qui s’y engagent créent un avantage compétitif clair : un accueil plus fluide, des impacts réduits et des clients mieux servis. Ne reste plus qu’à trouver le partenaire adéquat.
Merci à Myriam Laissy, Fondatrice et P-DG de Regency, pour son expertise et son éclairage précieux sur les enjeux de mobilité événementielle et les leviers concrets à actionner pour aider les lieux à reprendre la main.